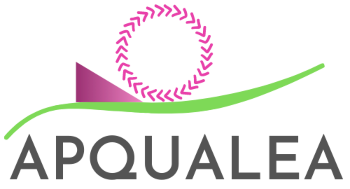Décryptage : la lutte contre la déforestation importée
Le principal moteur de la déforestation est l'expansion des terres agricoles liées à la production de produits de base tels que le bétail, le bois, le cacao, le soja, l'huile de palme, le café, le caoutchouc et certains de leurs produits dérivés, tels que le cuir, le chocolat, les pneus ou les meubles.
En tant que grande consommatrice de ces produits de base, l’Union Européenne a établi des règles visant à réduire au minimum sa contribution à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le monde dans le règlement UE n° 2023/1115 du 31 mai 2023.
Son application, d’abord prévue pour fin décembre 2024, a été repoussée au 31 décembre 2025 pour les grandes entreprises et au 30 juin 2026 pour les microentreprises et petites entreprises par le Règlement UE nº 2024/3234 du 19 décembre 2024. un nouveau report d'un an, soit au 31 décembre 2026 pour les grandes entreprises et au 30 juin 2027 pour les microentreprises et petites entreprises, a été décidé par le Règlement UE nº 2025/2650 du 19 décembre 2025.
Le 23 mai 2025, la Commission européenne a publié le règlement d'exécution UE n° 2025/1093 qui fixe la liste des pays présentant un risque faible et un risque élevé de non-conformité avec les objectifs de « zéro déforestation » de l'Union européenne.
APQUALEA fait le point sur les dernières évolutions de cette nouvelle réglementation et sur les obligations associées pour les entreprises concernées.
Les produits concernés par la réglementation sur la lutte contre la déforestation importée

La « déforestation » est définie comme la conversion des forêts à des fins agricoles, qu'elle soit d'origine humaine ou non, ce qui inclut les situations causées par des catastrophes naturelles.
La « dégradation des forêts » fait référence à une modification structurelle du couvert forestier, par exemple lors de la conversion de forêts primaires en forêts de plantation.
Le Règlement UE n° 2023/1115 du 31 mai 2023 établit des règles visant à réduire au minimum la contribution de l’Union Européenne à la déforestation et à la dégradation des forêts dans le monde, de façon à créer des chaînes d’approvisionnement agricoles plus durables.
Il cible spécifiquement les matières premières et les produits dérivés de matières premières dont l’exploitation est susceptible de contribuer à la déforestation ou à la dégradation des forêts, à savoir : les bovins, le cacao, le café, l‘huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois.
La liste complète des matières premières et des produits dérivés concernés est disponible dans l’Annexe I du Règlement UE n°2023/1115. On y trouve notamment, pour le secteur alimentaire :
- la viande bovine et les abats bovins, ainsi que les préparations en contenant, sous forme fraîche, réfrigérée, surgelée ou en conserve
- les fèves et pellicules de cacao, la pâte de cacao, le beurre de cacao, le chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao
- le café, même torréfié ou décaféiné, les coques et pellicules de café, les succédanés du café contenant du café
- les noix et amandes de palmiste, l’huile de palme et ses dérivés (acide palmitique, acide stéarique, acide oléique, glycérol…), les tourteaux de palme
- les fèves de soja, la farine de fève de soja, les tourteaux de soja, l‘huile de soja.
Ces produits ciblés ne pourront être mis sur le marché de l’UE ou exportés uniquement s’ils répondent aux trois conditions suivantes :
- ils sont zéro déforestation
- ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production
- ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée.
Les opérateurs concernés par la réglementation sur la lutte contre la déforestation importée
Le Règlement UE n°2023/1115 impose de nouvelles obligations aux opérateurs (fabricants, commerçants, négociants) qui mettent sur le marché de l’UE ou qui exportent à partir du marché de l’UE les produits de base ou les produits dérivés ciblés dans son Annexe I (cf paragraphe ci-dessus).
Il s’applique à compter du 30 décembre 2026 pour les grandes entreprises et du 30 juin 2027 pour les microentreprises et les PME.
Au sens du Règlement, une PME est une entreprise qui remplit 2 des 3 critères suivants :
- nombre moyen d'employés jusqu'à 250
- chiffre d’affaires net inférieur à 50 000 k€
- bilan inférieur au total de 25 000 k€.
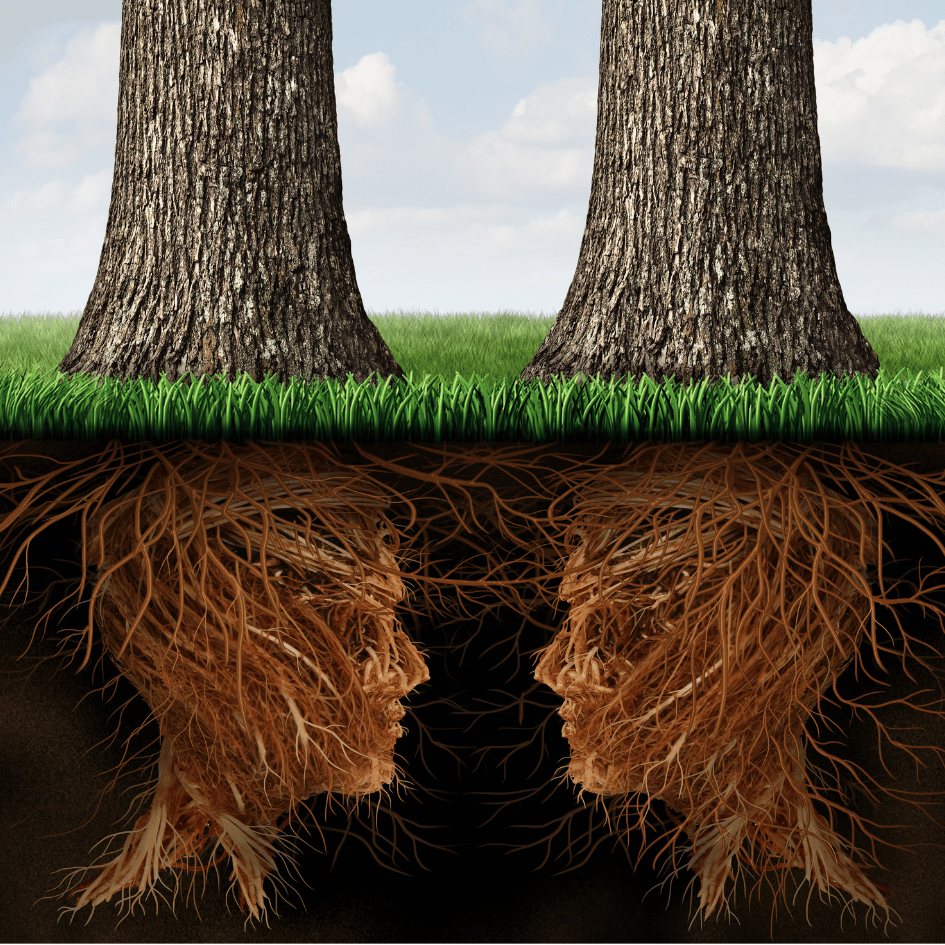
Le classement des pays en fonction du niveau de risque de déforestation

À l’entrée en vigueur du règlement UE n° 2023/1115, le 29 juin 2023, tous les pays se sont vu attribuer un niveau de risque standard. La Commission européenne a ensuite publié le règlement d'exécution UE n° 2025/1093 du 22 mai 2025 qui fixe la liste des pays présentant un risque faible et un risque élevé de non-conformité avec les objectifs de « zéro déforestation » de l’UE, sur la base des dernières preuves et données scientifiques internationalement reconnues concernant la déforestation.
Parmi les pays à faible risque, majoritaires, on retrouve notamment l'Allemagne, la France et le Canada. La liste des pays à risque élevé inclut, quant à elle, la Biélorussie, la République populaire démocratique de Corée, la Birmanie/Myanmar et la Fédération de Russie.
Le niveau standard est maintenu pour les pays qui ne sont pas répertoriés dans la liste des pays présentant un risque faible, ni dans celle des pays présentant un risque élevé. C’est le cas notamment du Brésil, de l’Indonésie et de la Malaisie bien qu’ils soient de gros producteurs de matières premières ciblées (café, soja, huile de palme).
Les obligations des entreprises concernées : le système de diligence raisonnée
Quel que soit le niveau de risque des pays d’origine des produits ciblés par la nouvelle réglementation, les entreprises qui les mettent sur le marché de l’UE ou les exportent doivent être en mesure de prouver que ces produits ne proviennent pas de terres récemment déboisées ou n’ont pas contribué à la dégradation des forêts.
Les opérateurs concernés doivent ainsi mettre en place et maintenir un système de diligence raisonnée pour chacun de leurs fournisseurs des produits ciblés, basé sur trois piliers : la collecte des informations, l’évaluation du risque et l’atténuation du risque.
La collecte des informations regroupe, pour chaque produit en cause : la description, la quantité, le pays d’origine et la géolocalisation des parcelles d’exploitation des matières premières ciblées avec la date ou période de production agricole, les coordonnées du fournisseur ainsi que les preuves attestant que le produit est zéro déforestation et qu’il a été produit conformément à la législation pertinente du pays de production.
Les opérateurs concernés doivent ensuite analyser les informations collectées pour évaluer le risque de non-conformité des produits ciblés vis-à-vis des exigences de l’UE, au travers de plusieurs critères, notamment :
- le niveau de risque du pays de production concerné
- la présence de forêts dans le pays de production
- la présence de populations autochtones dans le pays de production
- la qualité de la relation avec les populations autochtones dans le pays de production
- l’ampleur de la déforestation ou de la dégradation des forêts dans le pays de production
- les préoccupations concernant le pays de production (corruption, conflits armés, …)
- la complexité de la chaîne d’approvisionnement
- le risque de fraude, notamment de mélange avec des produits en cause d’origine inconnue ou concernées par la déforestation ou la dégradation des forêts
- les informations provenant de systèmes de certification ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers.
Si le risque évalué n’est ni nul ni négligeable, les opérateurs sont tenus de mettre en œuvre des procédures et des mesures d’atténuation avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter. Ces mesures sont, par exemple, des enquêtes, des audits, des tests traçabilité…
Les opérateurs sont enfin tenus de prendre des mesures pour atténuer et gérer efficacement les risques détectés de non-conformité des produits ciblés. Ces mesures consistent notamment à nommer un responsable de la conformité et à faire vérifier leurs politiques internes par un audit indépendant.
Ce système de diligence raisonnée doit être revu annuellement et les documents doivent être conservés 5 ans à compter de la date de mise sur le marché ou d’exportation des produits en cause. Il doit être tenu à disposition des autorités sur demande.
Ces éléments devront donc être intégrés aux dossiers de qualification des fournisseurs (fiches de spécifications, questionnaires fournisseurs…) et à l’évaluation du risque des matières premières en cause, notamment vis-à-vis du risque fraude, dans les industries agro-alimentaires concernées.
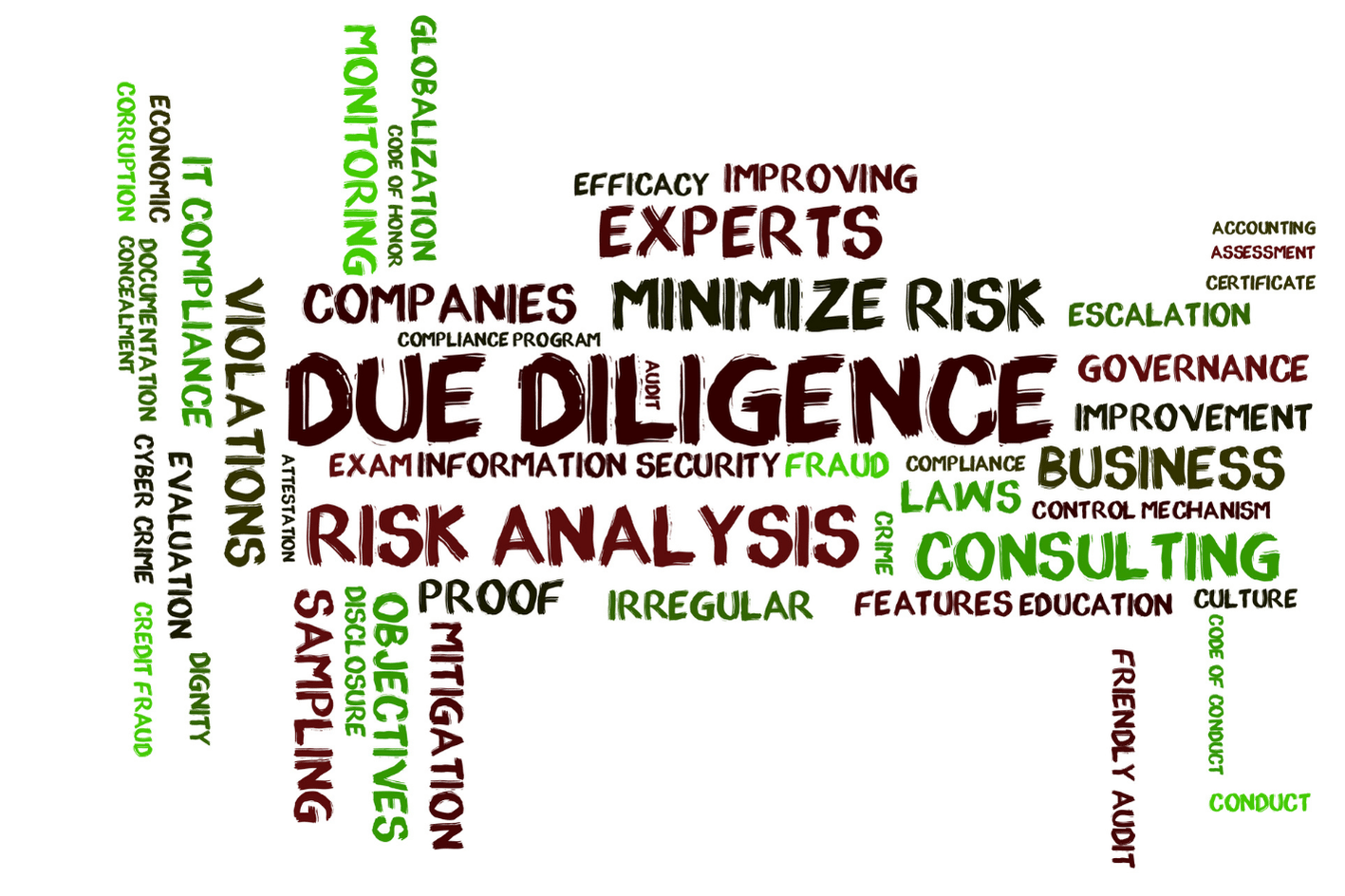
Les simplifications possibles du système de diligence raisonnée

Si tous les produits ciblés par la réglementation anti-déforestation sont issus de pays classés à faible risque, si la chaîne d’approvisionnement est maîtrisée et si le risque de fraude (mélange avec des produits d’origine inconnue ou à risque) est évalué comme négligeable, les opérateurs ne sont pas tenus de réaliser une évaluation du risque complète selon l’intégralité des critères ni de mettre en œuvre des mesures d’atténuation.
Pour les « micro ou petits opérateurs primaires », une déclaration unique simplifiée est adoptée, tenant compte des informations disponibles dans le système de l'UE. Un identifiant de déclaration est attribué à ces opérateurs après la présentation de leur déclaration unique simplifiée. L'identification et la conservation de la géolocalisation des produits pendant cinq ans peut être remplacée par l’adresse postale des parcelles ou de l’établissement où ils ont été produits.
Pour les « opérateurs en aval » (« toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met sur le marché ou exporte des produits en cause fabriqués à partir de produits en cause faisant tous l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée »), l’obligation de vérifier l’exercice de la diligence raisonnée ou de présenter des déclarations de diligence raisonnée est levée. Les « opérateurs en aval » doivent donc uniquement récupérer auprès de leurs fournisseurs les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou, le cas échéant, les identifiants de déclaration liés à ces produits.
Le système d’information : déclaration de diligence raisonnée, rapport annuel
Les opérateurs qui mettent sur le marché de l’UE (en premier dans la chaîne d’approvisionnement) ou exportent des produits ciblés doivent déposer leurs déclarations de diligence raisonnée par voie électronique dans le registre de déforestation créé par la Commission européenne, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter. Les entreprises peuvent présenter des déclarations de diligence raisonnée chaque année au lieu de chaque expédition ou lot mis sur le marché de l’UE.
Cette déclaration de diligence raisonnée contient les informations énoncées à l’annexe II du Règlement en ce qui concerne l’identification de l‘opérateur, les produits en cause (nature, quantité, origine) et une déclaration de l’opérateur selon laquelle il a exercé la diligence raisonnée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable. Ces déclarations seront vérifiées dans le registre et par les autorités des États membres.
Le système d’information est opérationnel depuis le 4 décembre 2024 ; les entreprises peuvent donc déjà y télécharger leurs déclarations.
Les opérateurs doivent également conserver un registre des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la déclaration est soumise dans le système d’information.
Les opérateurs doivent communiquer, aux opérateurs et aux commerçants situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement des produits en cause qu’ils ont mis sur le marché ou exportés, toutes les informations nécessaires pour démontrer que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable, y compris les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits.
Les opérateurs en aval et les commerçants recueillent les informations de traçabilité concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter. Ils conservent ces informations pendant au moins cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché :
a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des fournisseurs qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que, si leur fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits;
b) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des clients auxquels ils ont fourni les produits en cause.
Les opérateurs, hors PME et microentreprises, sont tenus de publier un rapport annuel sur leur système de diligence raisonnée, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises en vue d’honorer leurs obligations. Le premier rapport attendu portera donc sur les données de l’année 2027. Il devra comporter les informations suivantes :
- un résumé des informations concernant les produits ciblés (description, quantité, origine)
- les conclusions de l’évaluation du risque effectuée et les mesures d’atténuation prises, ainsi qu’une description des informations et éléments probants obtenus et utilisés pour évaluer le risque
- le cas échéant, une description du processus de consultation des populations autochtones, des communautés locales et des autres titulaires de droits fonciers coutumiers ou des organisations de la société civile qui sont présents dans la zone de production des produits en cause.

Les contrôles par les autorités

Chaque état membre de l’UE doit bâtir un plan de contrôle annuel intégrant au moins 1% des opérateurs mettant sur le marché ou exportant des produits ciblés issus de pays classés à risque faible, 3% des opérateurs mettant sur le marché ou exportant des produits ciblés issus de pays classés à risque standard et 9% des opérateurs mettant sur le marché ou exportant des produits ciblés issus de pays classés à risque élevé.
Des contrôles supplémentaires peuvent être réalisés en fonction des risques évalués. Les contrôles sont réalisés de façon inopinée.
En cas de suspicion d’un produit non-conforme, les autorités peuvent suspendre sa mise sur le marché ou son exportation. Dans le cas d’une détection d’un produit non-conforme, les actions suivantes peuvent alors être demandées à l’opérateur concerné :
- corriger la non-conformité formelle
- empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché ou l’exportation du produit en cause
- retirer ou rappeler immédiatement le produit en cause
- faire don du produit en cause à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, l’éliminer conformément au droit de l’UE en matière de gestion des déchets.
Des sanctions sont également prévues dans le Règlement en cas de non-respect des exigences : amendes, confiscation des produits en cause, confiscation des revenus associés aux produits en cause, exclusion temporaire de l’accès aux marchés publics, interdiction temporaire de mise sur le marché ou d’exportation, interdiction d’exercer la diligence raisonnée simplifiée.
Pour aller plus loin…
- Documentation d’orientation de l’UE
- FAQ (UE)
- Cadre de coopération internationale de l’UE
- Page d’information de l’UE relative à la nouvelle réglementation
- Page d’information sur le Forum vert de l’UE
- Fiche d’information concernant la gestion de la lutte contre la déforestation importée dans les PME
- Observatoire de l’UE sur la déforestation et la dégradation des forêts
- Guide d’utilisation du système d’information EUDR
- Guide d’achat public « Zéro déforestation » (notamment pour la restauration collective)
- Autres articles en lien avec le sujet et les discussions actuelles
L’International Featured Standards (IFS) s’est aussi emparé du sujet en créant un nouvel outil d’évaluation dédié : « IFS Deforestation Check ». Cet outil comporte une grille d’auto-évaluation qui peut être complétée par un audit sur site ou à distance.